|
Chapitre III : Système technique contemporain (STC)
(extrait de Michel
Volle, e-conomie, Economica 2000)
Le développement des nouvelles technologies découle des
progrès de l'électronique, et plus spécialement de la microélectronique. Après plus
d'un siècle pendant lequel les techniques dominantes ont été celles de la mécanique et
de la chimie, ce développement a donné à l'économie des orientations et priorités
nouvelles.
Il est corrélatif d'une hausse de la productivité du travail ;
plus rapide que celle de la production, cette hausse entraîne la baisse de l'emploi et
contribue donc au chômage. Il n'y a pas là, à première vue, une nouveauté : le
progrès technique a toujours suscité des hausses de productivité, et l'on a en mémoire
les résistances provoquées par la mécanisation au début du XIXe siècle. Cependant ici
la hausse de productivité est plus radicale qu'aux débuts de la mécanisation. Par
ailleurs, le développement des nouvelles technologies s'accompagne d'une mondialisation
de l'économie et d'une redistribution des cartes entre nations : chacune d'elles
peut se demander ce qu'elle sera devenue après cette redistribution.
Les enjeux des nouvelles technologies concernent donc à la fois
l'emploi et la richesse des nations. Nous allons nous efforcer de les situer sur une toile
de fond historique et économique.
1. Position du problème
Si les nouvelles technologies posent un problème, ce problème
est plus profond que celui immédiat et visible du chômage; il s'agit en effet d'assurer
la transition avec le minimum de crises vers un équilibre économique d'un type nouveau.
Il faut donc d'abord définir cet équilibre ; les responsabilités impliquées par cette
évolution concernent le corps social tout entier et ses principales institutions.
Le déclin de l'emploi ne s'explique pas par la baisse de la
production, ni par l'archaïsme de certains secteurs : il est général. Il touche non
seulement les activités en régression (construction navale, bâtiment, charbon, acier)
mais aussi les secteurs traditionnels en expansion (automobile, chimie) et les secteurs à
forte intensité technologique et forte croissance (télécommunications).
Les causes de cette évolution sont à rechercher dans l'automatisation.
La portée de celle-ci fait l'objet d'évaluations contrastées. Certains voient dans
l'éviction de l'homme du procès de travail " l'aboutissement naturel du
processus historique d'accumulation de la technique ". D'autres estiment que si
l'automatisation réduit l'emploi, elle permet une amélioration de la qualité et une
différenciation des produits ; cette possibilité devient une obligation pour les
entreprises lorsque la concurrence s'accroît, ce qui se traduit par une "
amplification du travail " pouvant entraîner finalement une augmentation et non une
diminution de l'emploi ; d'ailleurs, disent-ils, les installations automatisées
récemment davantage de personnel de service et d'entretien. D'autre part, les métiers
menacés par l'automatisation sont en moyenne moins qualifiés que les métiers dont elle
suscite le développement : l'approche quantitative de l'emploi devrait donc être
complétée par une approche qualitative.
Enfin le secteur tertiaire serait prêt à prendre le relais de
l'emploi industriel, de même que celui-ci a pris naguère le relais de l'emploi agricole
: orientée vers la qualité et la diversification des produits, l'industrie automatisée
réclame des réseaux commerciaux, des services après-vente, une adéquation fine de la
production aux besoins de la clientèle. La relation avec le client deviendra aussi
personnelle et assidue qu'au temps de l'artisanat et nécessitera de nouveaux emplois.
Chacune de ces objections apporte un éclairage sur ce que
pourrait être l'économie autour d'une production automatisée ; mais leur traduction en
termes quantitatifs ne permet pas d'espérer une inversion de la tendance fondamentale :
malgré l'accroissement des effectifs de service et d'entretien, ainsi que des personnels
des services commerciaux et d'après-vente, la hausse de productivité prévisible reste
supérieure à celle de la production, et une baisse de l'emploi parait inéluctable. Rien
ne garantit en tout cas que l’équilibre économique s’accompagne du plein
emploi.
Le cas des services fait l’objet d’une controverse.
Certaines études concluent à des hausses de productivité : le phénomène toucherait,
après l'industrie, le secteur tertiaire lui-même qui serait donc hors d'état de prendre
le relais de l'emploi. D'autres études au contraire concluent à l'inexistence ou au fort
ralentissement des gains de productivité dans le tertiaire. L'affaire est difficile à
trancher. Dans les services, le STC n'apporte pas vraiment une automatisation, comme il le
fait dans l'industrie avec la robotique, mais plutôt du " XAO ", de
l'assistance par ordinateur. L'opérateur humain garde sa responsabilité et son pouvoir
de décision, et l'ordinateur l'aide à les exercer en lui facilitant l'accès aux
éléments de décision (présentation du dossier client, recherche automatique dans la
documentation, etc.). La généralisation du XAO s'accompagne de changements de
l'organisation et du développement de tâches nouvelles jugées indispensables pour la
qualité.
Le bilan en termes de productivité est délicat, car sa mesure
pose des questions de classification, et par ailleurs les décisions nécessaires pour
tirer pleinement parti du STC sont lentes. Dans les secteurs caractéristiques du STC que
nous évoquerons en partie II, les gains de productivité ne sont niés par personne :
qu'il s'agisse de l'informatique, de l'audiovisuel, des télécommunications, du transport
aérien, des productions fortement accrues en volume et en qualité sont assurées avec
des effectifs stables, voire en régression.
Robert Solow a évoqué en 1982 le " paradoxe de la
productivité " : " on voit les ordinateurs partout, sauf dans les statistiques
de productivité ". Paul Strassmann a repris ce thème,
qui a suscité de nombreux débats. A vrai dire pour les praticiens qui mettent en
œuvre les nouvelles technologies dans les entreprises la question ne se pose
pas : que seraient les télécommunications sans la commutation numérique, que
serait le transport aérien sans les systèmes de réservation, que seraient la
comptabilité et la paie sans informatique ? S’interroger sur la productivité
apportée par les nouvelles technologies a pu être utile, lorsque leur mise en œuvre
était maladroite et qu’il fallait s’interroger sur les conditions précises de
leur bon usage ; même si les maladresses n’ont pas totalement disparu, nous
n’en sommes plus là.
Observons d’ailleurs que si les nouvelles technologies
apportent aux entreprises plus de productivité, il n’est pas certain qu’elles
leur apportent un profit accru : si toutes les entreprises d’un même secteur
mettent en œuvre les mêmes technologies, il peut en résulter une baisse du prix
dont le consommateur bénéficiera. C’est lui, en dernière analyse, qui sera le
destinataire du gain de productivité, et non l’entreprise ; mais cela ne remet
pas en question la réalité de ce gain.
2. Mise en perspective
Nous inspirant des travaux de Bertrand Gille. nous interprétons
la situation actuelle en utilisant la notion de " système technique ". Cette
situation serait caractérisée par l'émergence d’un " système technique
contemporain " (STC) faisant suite au " système technique moderne développé
" (STMD).
Bertrand Gille a décrit l’histoire de l’économie en
caractérisant chaque époque par le " système technique " qui lui
est propre. Alors que l'effort physique nécessaire à la production des biens
économiques était fourni, dans les sociétés antiques, par l'homme et les animaux, la
société mécanisée, née en Angleterre au XVIIIe siècle, confie à la machine
l'essentiel de l'effort physique. Son système technique repose sur la synergie entre
la chimie, la mécanique puis l'électricité. La mise au point de ses procédés
fondamentaux a eu lieu à la fin du XIXe siècle, sa mise en exploitation a marqué la
première moitié du XXe siècle.
Un nouveau système technique s'appuie dans la seconde moitié
du XXe siècle sur la synergie entre microélectronique, informatique et robotique, qui
détrônent mécanique et chimie dans le rôle de techniques fondamentales. L'usine est un
automate contrôlé par quelques personnes surveillant des écrans. L'automatisation fait
disparaître l'emploi industriel comme la mécanisation a fait disparaître l'emploi
agricole.
Le passage d'un système technique à un autre a des
conséquences sur les structures économiques ou institutionnelles. La disposition
physique de l’entreprise dépend elle-même du système technique :
- à l'énergie hydraulique correspond l'usine placée près d'un cours d'eau ; les
machines sont alignées le long d'un arbre de transmission ;
- avec la machine à vapeur, l'usine garde la même disposition, mais quitte le
voisinage des cours d'eaux pour celui des mines de charbon et des forêts ;
- avec le moteur électrique, l'alimentation en puissance ne dépend plus de
l'emplacement des machines ; le plan de l'usine se modifie pour minimiser la manutention.
Avec l'automatisation, des personnes qualifiées conçoivent
produits et techniques, fournissent des plans, schémas, programmes informatiques,
notices, instructions etc. Le coût de production physique est négligeable par rapport au
coût de conception. La distribution des produits nécessite des emplois de service.
On peut, avec le transistor, dater de 1947 le début de
l'automatisation, même si l'on en trouve les prémisses avant (électronique et
mécanographie) et si l’utilisation du transistor à grande échelle commence
seulement à la fin des années 50. L’automatisation vise à supprimer l'effort
mental demandé par la production. L'industrie mécanisée implique en effet, pour
le contrôle des machines, des tâches répétitives exigeant une attention pénible. Ces
tâches sont désormais assurées par des machines capables de percevoir, comparer et
contrôler.
Fonction de coût
La forme de la fonction de coût caractérise chaque phase de
cette évolution. Dans l'économie antique (travail manuel des esclaves), ainsi que dans
les formes primitives de l'agriculture, le coût est (pratiquement) proportionnel à la
quantité produite. Dans l'économie mécanisée, l'investissement initial permet de
réduire le coût marginal : le coût moyen décroît lorsque la production augmente
(" rendement croissant "), au moins jusqu'à un seuil au-delà duquel le
rendement devient décroissant, car on bute sur les difficultés d'organisation et
d'approvisionnement qui croissent avec la taille de l'entreprise.
Dans l'économie automatisée, seul l'investissement initial
coûte ; le coût marginal, coût de production d'une unité supplémentaire, est
(pratiquement) nul.
C'est le cas pour les composants électroniques et
logiciels : la copie d'un logiciel sur disquette ne coûte (pratiquement) rien
par rapport à son développement ; une " puce " électronique ne
coûte (pratiquement) rien par rapport au coût de sa conception, (comme la
microélectronique se substitue aux engrenages pour la transmission des commandes et
informations qui règlent le fonctionnement des machines, sa fonction de coût se répand
dans tous les secteurs). On parle de " fonction de production à coût fixe ".
Les rendements sont alors fortement croissants.
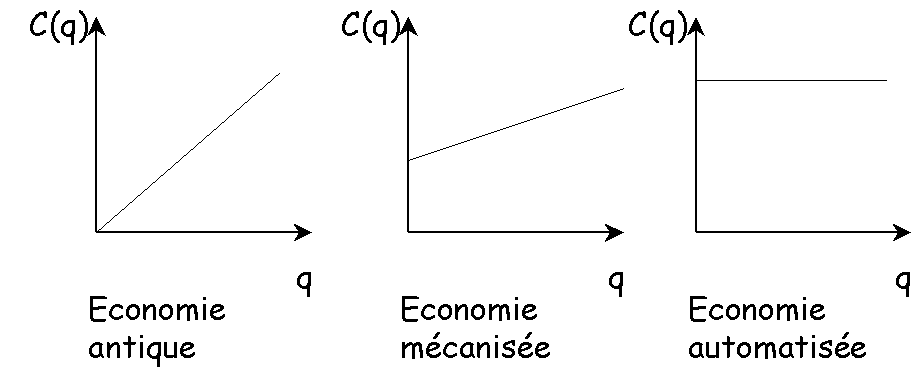
Il est possible d’aborder la fonction de coût à partir de
plusieurs points de vue, selon le niveau d’agrégation utilisé. Nous distinguerons
trois niveaux d’agrégation, la production des niveaux agrégés s’obtenant par
" empilage " des productions des niveaux inférieurs ; pour
chacun de ces niveaux, la liste des endogènes et exogènes est différente :
1) l’entreprise est dotée d’une fonction
de production et insérée dans le marché. Pour elle, les coûts w et r des facteurs de
production sont exogènes, car ses possibilités d’action sur ces prix là sont
faibles (sauf si elle est en situation de monopole d’achat). Le prix p auquel elle
vend son produit est lui aussi exogène si elle est petite par rapport au secteur auquel
elle appartient.
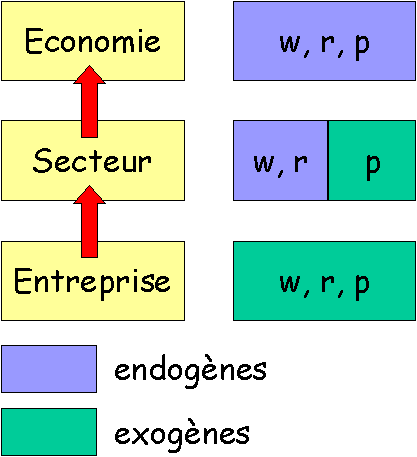
2) Le secteur regroupe les entreprise produisant un
même produit (ou des variétés du même produit) et qui sont donc en concurrence. Nous
supposerons qu’un secteur est petit par rapport à l’ensemble de
l’économie : les niveaux w et r des prix des facteurs de production lui sont
donc exogènes, car ils se déterminent sur l’ensemble de l’économie. Par
contre le prix p du produit est endogène au secteur.
Le secteur est identique à une seule entreprise en cas de
monopole. En situation de concurrence (même monopoliste) il se compose d’un grand
nombre d’entreprises. Nous n’examinerons pas ici les situations
d’oligopole. La fonction de production du secteur s’obtient en
" empilant " la fonction de production des entreprises qui le
composent, que l’on supposera toutes identiques par souci de simplicité.
3) L’économie prise dans son ensemble (ou macroéconomie)
regroupe tous les secteurs, donc toutes les entreprises. La fonction de production
macroéconomique s’obtient en empilant les fonctions de production des secteurs. Les
prix des facteurs w et r, ainsi que le prix p du PIB, sont alors endogènes. Si l’on
considère une fonction de production agrégée, censée représenter le fonctionnement
d’ensemble de l’économie, il faut en effet considérer aussi les marchés sur
lesquels se déterminent les prix des facteurs w et r, endogènes à l’équilibre de
ces marchés.
Considérons une entreprise dont la fonction de production (au
sens étroit) est à coût fixe. Elle bénéficie de rendements croissants. Cependant
l'économie considérée dans son ensemble se comporte comme si la fonction de production
était à rendements décroissants.
La fonction de production sectorielle est obtenue par
l’empilage de fonctions de production d’entreprises supposées identiques.
Si l’on demande au secteur de produire davantage, de nouvelles entreprises devront
être créées, utilisant chacune les mêmes quantités de facteurs que les entreprises
existantes, et produisant la même quantité du bien. L’empilage sectoriel des
entreprises a donc une fonction de production à rendement constant (on trouvera en annexe
à ce chapitre le calcul explicite de la fonction de production sectorielle lorsque la
fonction de production de l’entreprise est à facteurs complémentaires).
Au niveau macroéconomique, où l’on considère non plus
une entreprise ni un secteur mais un pays entier, on ne peut plus considérer les coûts
unitaires w et r comme des exogènes : ils sont fonctions croissantes de L et de K
parce que l’offre des facteurs est limitée (ou autrement dit parce qu’elle
comporte pour le possesseur du facteur une désutilité croissante avec le niveau de leur
utilisation). Dès lors la fonction de coût macroéconomique, construite en associant une
fonction de production (physique) à rendement constant avec des coûts unitaires
croissants, sera une fonction de coût à rendement décroissant.
On retrouve donc, au niveau macro-économique, une productivité
marginale décroissante. L'économie prise dans son ensemble se comporte donc comme si la
fonction de production était à rendement décroissant.
Ainsi le formalisme des rendements décroissants reste utile. Le
commerce international s'équilibrera selon les hypothèses du modèle de Arrow-Debreu,
qui suppose des rendements décroissants, alors que l'économie interne à une nation doit
prendre en compte le rendement croissant de la fonction de production de
l’entreprise.
Coût fixe ou fonction affine ?
Lorsque l'on dit que la fonction de production est " à
coût fixe ", on entend le terme " production " au sens étroit de
" production matérielle d'un bien ". Si on l'entend au sens large
qu’il doit avoir en économie (" contribuer à la satisfaction du
consommateur "), il faut inclure dans la production tout ce qui contribue à
mettre le bien entre les mains du consommateur final, et donc notamment la distribution.
Si le coût de la distribution est fonction linéaire des
quantités vendues, la fonction de coût est affine, la partie fixe représentant le coût
de production matérielle, la partie linéaire représentant le coût de
distribution ; le rendement resterait croissant, mais le coût marginal ne serait pas
nul.
Cette remarque est contredite par plusieurs faits :
- la rémunération de la distribution est souvent définie comme un pourcentage du
coût de production. Si la fonction de production du bien est à coût fixe, tout se passe
comme si le coût fixe était plus élevé. Le coût marginal est nul, la fonction de
coût " au sens large " est elle aussi " à coût
fixe " et n’est donc pas affine ;
Supposons en effet que le coût fixe de production soit c, que
la quantité vendue soit q, que le producteur travaille à profit nul, et que la
distribution prenne un pourcentage t
sur le prix de vente.
Le prix de vente est alors p = c(1 + t)
/q : tout se passe donc comme si le
coût fixe avait été multiplié par (1 + t).
- certaines des dépenses liées à la distribution (études marketing et
tarifaires, publicité, observation du comportement des clients) ne dépendent pas du
volume vendu, même si elles ont pour but de l’accroître, et font donc partie du
coût fixe ;
- la mise en place d’un réseau de distribution ou d’un service
d’e-commerce sur l’Internet a elle aussi un coût indépendant de la quantité
vendue ; en fait son coût est, comme celui de tout réseau, un coût de
dimensionnement. En exploitation, il se comporte comme un coût fixe tant que
l’on ne bute pas contre la dimension limite du réseau. Nous étudierons ce type de
coût au chapitre VIII.
La compétence considérée comme un actif ?
Si le coût de production devient pour l’essentiel un coût
fixe de conception, la compétence devient l'actif principal de l'entreprise. Or la
compétence se sépare en deux parties : d'une part le savoir contenu dans la tête d'une
personne, d'autre part les conditions pratiques que l'entreprise offre à cette personne
et qui permettent de faire fructifier son savoir. C'est en fait le couple "
compétence personnelle - entreprise efficace " qui constitue véritablement un actif
: la personne compétente porte dans sa tête un capital personnel, mais sauf dans le cas
de l'entreprise individuelle ce capital ne pourra se concrétiser que si une entreprise
lui fournit un environnement favorable. Une entreprise qui sait employer des ingénieurs
compétents a " de la valeur " parce qu'elle montre sa capacité à les attirer
et à les retenir, indice favorable de la qualité de son organisation et de son aptitude
à utiliser des compétences.
L'évaluation d'un tel actif est délicate, et les comptables
préfèrent souvent lui supposer une valeur nulle par application du " principe de
prudence ". Cependant les opérations de fusion ou absorption nécessitent
d’estimer la valeur d'une entreprise ; les calculs des chargés d'étude s'écartent
alors de la démarche comptable et tiennent compte de cet actif. Ils anticipent ainsi sur
une évolution nécessaire de la comptabilité : on ne pourra pas continuer à appliquer
le " principe de prudence " de la même façon alors que
l'" immatériel " - organisation, compétences, marque - devient
prépondérant dans l'actif des entreprises.
3. Dynamique des systèmes techniques
Un système technique, c'est l'ensemble des relations et
dépendances mutuelles entre les technologies utilisées par l’appareil productif et
les filières selon lesquelles il s’organise. Un système technique germe lorsque
se produisent les inventions qui donnent naissance à ses composantes ; il s'épanouit
lorsque s'installent les synergies qui lui confèrent sa fécondité, une phase de
croissance économique accompagnant alors l'accélération de l'innovation; il plafonne
lorsque, ses potentialités étant toutes exploitées, la croissance s'enlise alors
que germe le système technique suivant.
Selon ce modèle, l'évolution économique serait déterminée
principalement par la genèse, la croissance et le blocage des systèmes techniques qui se
succèdent, le passage d'un système au suivant étant caractérisé par une crise.
Cette approche introduit dans l'histoire économique une
pulsation semblable à celle des cycles de Kondratieff (sans rechercher toutefois une
régularité artificielle), et confère à l'innovation un rôle moteur conforme aux
intuitions de Schumpeter.
Le système technique contemporain
Utilisant la méthode de Bertrand Gille, Cristiano Domingues a
proposé une fresque des systèmes techniques. Il a établi une chronologie sommaire qui
met en perspective le système technique contemporain :
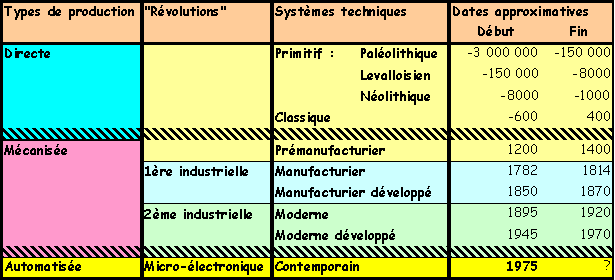
Chronologie des systèmes techniques
Le " système technique moderne
développé " (STMD) était caractérisé par la prédominance des filières
mécanique et chimique, la chimisation et le bouleversement de la filière métallique, le
déploiement de l'électromécanique ; il a représenté la phase la plus achevée de
la production mécanisée, celle où taylorisme et fordisme ont porté tous leurs fruits.
Il a buté contre un triple blocage :
- le développement des matériaux de synthèse a mis à mal la filière acier ;
- la chimisation de toutes les filières a abouti à un éclatement de la filière
chimique elle-même ;
- le développement du taylorisme et du fordisme a atteint ses limites, en raison
de l'importance des temps de transfert et de la rigidité de la production.
Par ailleurs la spécialisation des machines et des chaînes de
production est entrée en contradiction avec un marché sur lequel les normes de
consommation évoluaient rapidement.
La crise actuelle serait donc due à la fois à l'épuisement
des potentialités du STMD, qui a poussé à l'extrême la production mécanisée, et à
l'émergence du STC, caractérisé par la production automatisée. Giarini et Loubergé
ont proposé une explication complémentaire de celle-ci. Selon eux, le développement
économique nécessite un potentiel technologique - c'est-à-dire un écart
entre les possibilités offertes par l'état de la science et celles exploitées dans la
production. Ce potentiel ouvre des perspectives de profit aux entrepreneurs, et ils les
exploitent si les conditions sociales, culturelles et politiques le permettent. La
croissance de 1945 à 1970 serait due à un rattrapage, le potentiel scientifique
de la fin du XIXe siècle n'ayant été que très incomplètement exploité avant-guerre
en raison de blocages culturels ou sociaux. Le ralentissement de la croissance
s'expliquerait par le fait que ce rattrapage est achevé, et que la science n'a plus assez
d'avance pour nourrir un flux accéléré d'innovations - sauf justement dans les
applications de l'informatique et de la biotechnologie.
Synergie propre au STC
Le STC se caractérise par la synergie de trois technologies : microélectronique,
robotique, informatique.
L'histoire de la microélectronique débute en 1947 avec
l'invention du transistor, puis se poursuit avec les circuits intégrés, les
microprocesseurs, l'accroissement de la capacité des mémoires, la miniaturisation.
Cette technologie est exploitée par les ordinateurs, les
machines-outils à commande numérique et les robots. Les applications envahissent le
domaine des activités productrices, comme le montre la liste des activités "
assistées par ordinateur " ou " XAO " : conception (CAO), dessin
(DAO), gestion (GAO), gestion de production (GPAO), fabrication (FAO), et encore
maintenance, manutention, contrôle, assemblage. Dans la panoplie des robots, on remarque
ceux qui contrôlent leur propre usure et déclenchent eux-mêmes leur approvisionnement
en pièces de rechange ; ceux qui, dotés de capteurs optiques, réalisent le contrôle de
qualité dans des conditions d'exhaustivité et de rapidité que l'on n'aurait jamais pu
demander à un opérateur humain. L'abondance des néologismes reflète la floraison des
applications : bureautique, monétique, connectique, collectique, Internet, Intranet,
Extranet etc.
Le système productif dont nous avons esquissé la description
est dominé par trois maîtres mots : flexibilité, qualité, productivité. L'industrie
automatisée, ce ne sont plus les gros centres d'emploi de l'ère taylorienne ; ce sont de
petits établissements très capitalistiques, capables de produire en petite ou moyenne
série de façon rentable, de réorienter leur production et donc de suivre la demande
dans ses évolutions, capables aussi de s'associer entre eux selon des formules de
partenariat ou de sous-traitance. Avec les réseaux locaux de PC (RLPC), les interfaces
graphiques et la structuration des processus de travail
(" workflows "), le " XAO " s’est
généralisé à toutes les activités de l’entreprise, y compris au travail de
bureau.
Ce qui garantit la victoire du STC sur le STMD, c'est sa
rentabilité. Les investissements initiaux sont élevés, mais compensés par les gains
réalisés sur les coûts de production, les temps de fabrication, la gestion des stocks.
Si des blocages culturels où institutionnels s'opposent à son triomphe, il s'impose par
sélection naturelle. Les entreprises dans lesquelles " ça bloque "
disparaissent, et avec elles le système technique auxquelles elles s'attachaient.
La liste d'innovations que nous avons évoquée, leur
cohérence, leur synergie, indiquent que le STC, en tant que concept, est une hypothèse
historique plausible. Cependant le taylorisme et le fordisme avaient marqué non seulement
nos entreprises, mais notre culture et nos institutions. Le passage du STMD au STC fait
craquer cet édifice.
Part des activités dans la création de richesse
Pour les physiocrates du XVIIIe siècle, la richesse résidait
dans la production des matières premières. Les activités les plus importantes étaient
donc pour eux l'agriculture et les mines. Ils accordaient moins d’importance à
l’industrie, qui ne fait que " transformer " les matières
premières.
Cette façon de voir s’est estompée au XIXe siècle, lors
de l’industrialisation, et elle nous est aujourd’hui totalement étrangère.
Cependant nous sommes souvent captifs d’un point de vue hérité de l’époque
industrielle, le " productivisme ", qui assimile la richesse à la
production de biens (et non à celle de la valeur ajoutée), et qui sera aussi étranger
à nos descendants que le point de vue des physiocrates nous l’est devenu. Il est
vrai qu’il a pour lui le poids d'une fausse évidence, la " réalité " que
confère aux biens leur apparence matérielle. La part de l'" immatériel "
(marketing, " design ", publicité) dans certains biens même simples,
comme un pot de yaourt, représente plus de 70 % du coût de production. Cependant les
activités " productives " au sens physique du mot (agriculture, industrie)
occupent encore dans l'imaginaire collectif une place disproportionnée à leur importance
dans l'emploi.
Pour comparer ces représentations à la réalité, il est utile
de considérer des séries longues. Certes on doit pour établir de telles séries
surmonter quelques difficultés conceptuelles, car le sens des mots et donc des
catégories statistiques a évolué. Elles sont néanmoins utiles lorsqu'elles révèlent,
comme c'est le cas ici, une évolution dont le sens est sans ambiguïté. Voici donc
l'évolution de la population active française par grand secteur d'activité depuis 1806
(la série s'interrompt pendant les guerres) :
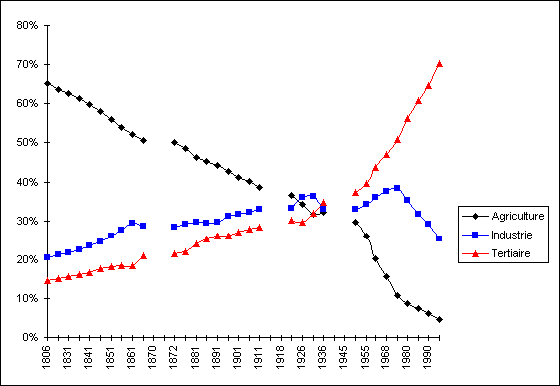
En 1806, l'agriculture employait 65 % de la population active,
l'industrie 20 % et les services 15 %. En 1996, l'agriculture emploie 4,50 % de la
population active, l'industrie 25 % et les services 70 %.
On distingue trois périodes dans cette évolution : la
première va de 1806 à 1936, la deuxième de 1949 à 1974, la troisième débute en 1974
et n'est pas achevée.
De 1806 à 1936, la croissance des services et de l'industrie se
fait parallèlement, au détriment de l'agriculture. Les effectifs de l'industrie sont
supérieurs à ceux des services. Vers 1936, l'emploi se partage par parts à peu près
égales entre les trois secteurs. Après 1949, l'emploi dans les services devient
supérieur à l'emploi dans l'industrie. Le déclin de la part de l'agriculture se
poursuit, mais les services et l'industrie continuent à croître parallèlement jusqu'en
1974. La part de l’industrie atteint en 1974 son maximum historique à 38,5 % de la
population active. Puis elle entame une rapide décroissance, alors que la part de
l'emploi dans les services continue à croître.
Le premier choc pétrolier semble donc avoir été pour
l'industrie le signal déclencheur après lequel les effets de l'automatisation ont joué
à plein : on n'observe pas de relance de l'emploi industriel à l'occasion du contre-choc
de 1978, alors que celui-ci aurait dû compenser les effets du choc de 1974.
Si les services sont le secteur qui fournit le plus d'emplois,
ils restent mal connus. L'appareil statistique public, dont la structure reflète les
priorités collectives, s'est orienté d'abord vers l'agriculture, puis vers l'industrie.
L'effort de connaissance consacré aux services reste faible.
Le contenu des services a fortement évolué. Au début
du XIXe siècle, les emplois de service sont pour une grande part des emplois de
domestiques ; ces emplois ont par la suite pratiquement disparu : ils représentaient
30 % des emplois tertiaires et 5,5 % des actifs en 1851, ils ne représentent que 2,6 %
des emplois tertiaires et 1,4 % des actifs en 1982. La hausse de la part des services dans
l'emploi serait donc plus rapide encore si l'on ôtait du calcul les emplois de
domestiques.
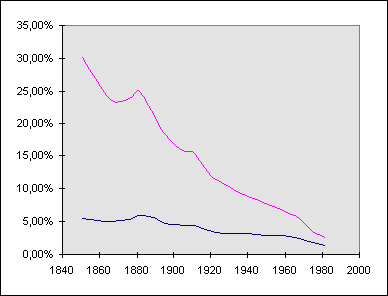
Part des domestiques dans les emplois tertiaires et dans l'emploi total
Les emplois de service se répartissent ainsi en 1996 : 20 %
dans les services non marchands (État sauf PTT, collectivités locales, Sécurité
sociale), 45 % dans le tertiaire marchand (transport, commerce, services aux entreprises
ou aux ménages). Les services occupent plutôt des femmes : 75 % des femmes et 50 %
des hommes ayant un emploi travaillent dans les services, alors que l'industrie occupe 18
% des femmes et 40 % des hommes.
À partir du début des années 60, le nombre d'employés et de
cadres augmente d'environ 270 000 personnes par an jusqu'à aujourd'hui, avec un
ralentissement en fin de période. La tertiarisation de la France succède à son
urbanisation et son industrialisation. " Le bureau, l'hypermarché, l'hôpital
l'école supplantent l'usine et l'atelier comme lieu de travail caractéristique. La
classe ouvrière se réduit et se transforme." Le volume des services aux entreprises
a été multiplié par 8 depuis les années 60, et ils représentent en 1995 deux tiers
des services marchands. Ce sont les services informatiques, les télécommunications et le
conseil qui ont eu la croissance la plus rapide.
Le constat de la tertiarisation ne peut pas être considéré
comme une " preuve " de la validité de notre modèle. Toutefois il ne le
contredit pas, car il est conforme à ce que l'on pourrait en déduire.
Il apporte en outre une indication sur la part de l'économie
que l'on peut décrire avec ce modèle, ainsi que sur son évolution. Si l'économie
était conforme au modèle, presque tous les emplois se trouveraient dans les services, la
part de l'agriculture et de l'industrie se réduisant à peu de chose en raison de
l'automatisation de la production.
Ajoutons que des évolutions analogues à celle décrite ici
pour la France se rencontrent dans tous les pays développés (États-Unis,
Grande-Bretagne, Allemagne, Japon etc.), qui sont souvent plus avancés encore que la
France dans la voie de la tertiarisation.
4. Conséquences économiques
Pour explorer les conséquences économiques du STC, nous allons
les schématiser.
Considérons une économie sans échanges extérieurs, par
exemple une île coupée du reste du monde, ou encore le monde entier. Opposons deux
situations extrêmes : l'une dans laquelle le coût de production d'un bien serait
proportionnel à la quantité produite (rendement constant) ; l'autre où ce coût serait
indépendant de la quantité, ce qui caractérise la production automatisée. Supposons
que le travail soit le seul facteur de production, que ce soit sous la forme d'un flux
employé pour la production ou d'un stock incorporé dans un capital. Nous construirons
deux modèles simples représentant chacun l'une de ces situations.
Rendement constant
Supposons que l'économie comporte deux biens X et Y dont les
fonctions de production sont :
X = aLx
et
Y = bLy
où Lx et Ly sont les quantités de
travail affectées chacune à la production d'un bien. Si L est la quantité de travail
totale fournie en une année, on a :
(3) Lx + Ly £ L
L'ensemble des productions annuelles possibles est représenté
dans le plan (X,Y) par un triangle.
Zone de production
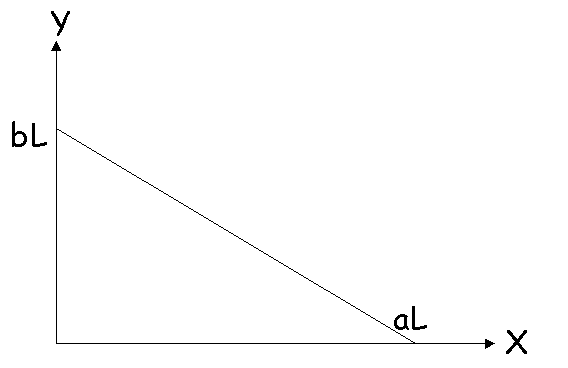
Supposons maintenant que l'utilité des consommateurs soit une
fonction quasi concave de X et de Y, et supposons négligeables les questions
d'agrégation des préférences individuelles que soulève une fonction d'utilité
collective :
(4) U = U(X, Y)
Les courbes d'indifférence U(X,Y) = cte ont approximativement
la forme d'un arc d'hyperbole.
Production optimale
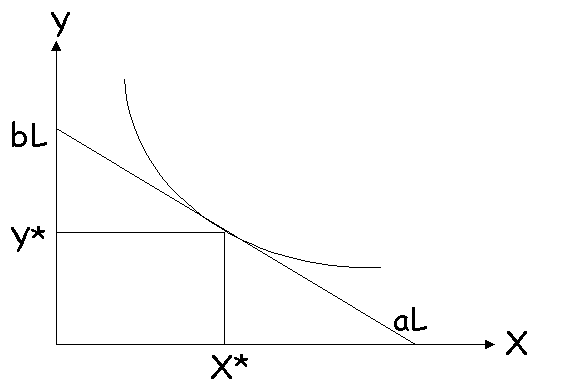
Sous de telles hypothèses, l'optimum économique est atteint si
la répartition des facteurs est (Lx*, Ly*), permettant la
production (X*,Y*); le point (X*,Y*) est, sur la frontière du triangle représentant les
productions possibles, celui qui maximise l'utilité.
Les productions optimales X* et Y* dépendent à la fois de
la zone de production - qui dépend elle-même du travail disponible L et des technologies
représentées par les coefficients a et b - et de la fonction d'utilité U(X,Y).
Économie à coût fixe
Supposons que le coût de production d'un bien soit indépendant
de la quantité produite : produire nécessite du travail pour concevoir et installer
l'usine, les machines, les programmes, mais une fois cet investissement consenti la
production ne requiert plus de travail. Supposons que la quantité de travail nécessaire
pour lancer la production d'un bien soit W, identique pour tous les biens.
Dans une telle économie, l'utilité des consommateurs ne peut
plus dépendre de la quantité produite, puisque celle-ci n'ayant pas plus de
limites que l'air que l'on respire les besoins quantitatifs sont saturés.
Par contre, l’utilité dépend du nombre de produits
disponibles, de leur différenciation face à la diversité des goûts et besoins.
D'une économie de la quantité, on est passé à une économie de la qualité, chaque
bien étant caractérisé par ses propres paramètres qualitatifs (le terme
" qualité " ne désigne pas ici une échelle où la qualité se
mesurerait dans le sens du plus ou du moins, mais la diversité des biens disponibles).
L'arbitrage doit alors se faire entre le temps de loisir T et la
différenciation des biens. Supposons le temps réduit à une seule période. Soit L
le temps de travail maximum disponible durant cette période, L le temps de travail
effectif, T = L - L le temps de loisir ; la fonction d'utilité sera
(5) U = U(n,T)
où n est le nombre de biens disponibles ; comme
(6) L = n*W
on obtient les quantités (n*, L*) caractérisant l'optimum
économique en pratiquant une maximisation sous contrainte analogue à celle du modèle
précédent.
Différenciation optimale
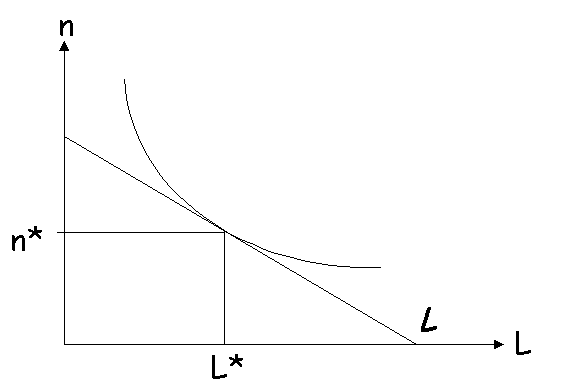
Le seul mérite de ces formalismes sommaires, c'est d'inciter à
poser clairement les hypothèses et de conduire aux remarques que voici :
Les fonctions d'utilité auxquelles nous sommes habitués, du
type U(X, Y), sont fonction croissante des quantités consommées et correspondent à des
économies restées proches de la pénurie : la liste des produits disponibles est fixée a
priori, et le consommateur serait toujours plus satisfait s'il disposait d'une unité
de plus de chaque produit.
Or les économies développées se sont éloignées de la
pénurie. Des phénomènes de saturation existent pour certains biens (biens alimentaires,
biens de consommation durables). Dans les classes aisées des pays riches, le bien-être
du consommateur dépend moins de la quantité de biens qu'il consomme que de la
possibilité de se procurer des biens correspondant à ses goûts (habillement, livres,
spectacles). Nous sommes donc déjà, pour certaines parties de la population et pour
certains biens, passés d'une économie de la quantité à une économie de la qualité,
ce dernier terme étant entendu au sens de "diversification des attributs " et
non pour évoquer des produits de haute qualité (la " qualité ", au
sens de finition et de fiabilité, n'est de ce point de vue qu'un attribut parmi
d'autres).
L'automatisation fait accéder l'ensemble de la population à ce
type d'économie par la diversification des produits et la baisse des prix. Dès lors le
statut du travail change. Il ne s'incarne plus dans les quantités produites, mais dans le
capital fixe constitué par le stock de compétences et le stock des travaux de conception
accumulés, tous deux liés à la diversification qu’ils conditionnent. L'arbitrage
entre loisir et différenciation des produits peut conduire à des équilibres comportant
un temps de travail différent inférieur à celui habituel aujourd'hui. La signification
du travail change, ainsi que celle de sa rémunération ; le mot " chômage "
n'a plus le même sens.
La relation entre les hommes et la nature est donc modifiée,
tout au moins la partie de cette relation qui consiste à utiliser les ressources
naturelles et les possibilités techniques pour se procurer le bien-être matériel. Nous
nous trouvons alors dans un monde différent du monde actuel en ce qui concerne les
valeurs, les modes de vie et l'organisation économique : en effet, l'équilibre d'une
économie à coût fixe n'est pas décentralisable comme celui d'une économie à
rendements décroissants et pose des problèmes d'organisation spécifiques.
4. STC, emploi et distribution de richesse
Une nouvelle structure de l'emploi
Avec le STC, l'emploi réside essentiellement dans le tertiaire.
La production matérielle et l'agriculture emploient chacune au plus quelques pour cent de
la population active ; la compétence, qui constitue l'actif le plus précieux du STC, est
mobilisée par des tâches de conception et d'expertise. Elle se concentre dans des "
bassins de compétence " (Silicon Valley, région de Boston, zone de Saclay,
Sophia Antipolis, etc.) où les concepteurs peuvent trouver des rapports interpersonnels
stimulants et le contexte universitaire qui les aide à se maintenir sur le front de
taille de la recherche. L’histoire du PARC de Xerox, placé à Palo Alto tout près
de l’université de Stanford, est exemplaire à cet égard. La gestion des ressources
humaines dans les bassins de compétence requiert un savoir faire très délié, comme en
témoigne l’histoire du langage Java chez Sun.
Au plus près des clients se dissémine une première ligne composée
des personnes qui assurent la distribution, l'information des clients et la maintenance.
Ces services sont essentiels à l'efficacité d'une économie de la différenciation.
Considérons les équipements qui en quelques décennies ont transformé chaque
appartement en petit musée des nouvelles technologies ou encore ceux utilisés par les
entreprises : si les produits du marché se distinguent peu par leurs performances, le
fournisseur est choisi selon sa compétence pour aider le client à trouver la variété
correspondant au mieux à ses besoins, et selon la qualité de son service après-vente
(rapidité des dépannages, clarté des explications) car le client ne tolère pas qu'un
équipement reste en panne.
Ce schéma (bassins de compétence concentrés, première ligne
disséminée, production matérielle pratiquement sans emploi et à localisation
indifférente) indique que la richesse des nations dépendra d'abord de leur
capacité à constituer ou attirer des bassins de compétence, puis à entretenir une
première ligne de qualité. La culture industrielle, qui donnait la priorité à
l'organisation de la production matérielle, garde sa pertinence dans son domaine propre
mais n'aide pas à traiter ces questions nouvelles.
Ce schéma fait aussi apparaître un piège sur le chemin qui
mène à l'économie du STC : celui du chômage, de l'exclusion, et de la rupture de la
cohésion sociale. L'économie du STC est certes la plus riche, la plus productive que
l'humanité ait jamais connue ; mais les tâches de production matérielle s'y font
pratiquement sans recours à l'emploi. Or dans l'économie industrielle la production
matérielle utilisait abondamment la force de travail des hommes, et en outre cette
économie comportait une distribution de richesse naturelle et simple par le mécanisme du
salariat. L'économie du STC ne dispose plus de ce mécanisme de distribution, ou du moins
il n'y possède plus la même généralité. Elle semble par ailleurs pouvoir se passer de
la force de travail des êtres humains, au moins pour la production physique. Cette force
de travail devra donc trouver à s'employer selon des formes nouvelles.
Deux stratégies opposées sont aujourd'hui mises en œuvre
pour répondre aux difficultés résultant de la disparition progressive de l'emploi
industriel. Aux États-Unis, terre d'immigration, la priorité est de fournir aux nouveaux
arrivants les moyens de vivre tout en s'intégrant ; d'où la multiplication des "
petits boulots ", emplois précaires à bas salaire permettant d'attendre des jours
meilleurs, et la faiblesse du taux de chômage. En Europe, où l'on se fait une haute
idée des droits du salarié citoyen, les garanties de salaire minimal et de stabilité de
l'emploi sont maintenues, le chômage est indemnisé, mais le taux de chômage est
élevé. Chacun de ces systèmes construit une société duale à sa façon, là-bas par
l'extrême dispersion des revenus, ici par la constitution d'une population assistée
d'exclus du monde du travail. La comparaison entre ces deux systèmes doit tenir compte
des contextes historiques qui les ont engendrés. Aucun des deux ne répond convenablement
aux défis du passage au STC.
Évolution de la demande
L'équilibre et la dynamique économiques sont déterminés par
la confrontation entre fonctions d'utilité des consommateurs et fonctions de production
des entreprises. Mais les deux termes de cette confrontation ne sont pas indépendants. À
la modification radicale de la fonction de production qu'apporte le STC correspond une
modification également radicale de la façon dont les besoins des consommateurs sont
satisfaits.
En effet la fonction d'utilité d'un consommateur traduit
conjointement ses besoins et sa connaissance de l'offre. Cela se manifeste à travers
sa demande, qui dérive de la fonction d'utilité quand sont donnés revenus et
prix. Si par exemple les êtres humains ont toujours eu besoin de se parler à distance,
ce besoin n'a pu s'exprimer sous forme de demande qu'après l'invention du téléphone, ou
plus exactement après que le service téléphonique fût devenu assez connu, et assez
répandu, pour être socialement désirable et même indispensable.
Le passage au STC comporte un changement des habitudes de
travail et des modes de vie dans les pays les plus riches. L'ère de la production
diversifiée, et de la qualité dans la diversification, succède à celle de la
production standardisée de masse à bas coût, qui avait elle-même succédé à celle de
la pénurie et de l'artisanat. Les besoins fondamentaux sont désormais satisfaits, la
durée de vie est longue, les machines soulagent l'effort de travail tant au domicile
qu'au bureau. L'emploi du temps et le style de vie de la classe moyenne s'est étendu à
presque toute la population. Il n'est certes pas facile pour tout un chacun d'inventer le
langage, les concepts et les images permettant de dire, penser et communiquer dans une
situation dont la nouveauté déconcerte les acquis culturels. Les fautes de discernement
et de goût du nouveau riche deviennent collectives. L'adaptation des modes de vie prend
un délai pendant lequel certains besoins restent refoulés, inexprimés, et cependant
ressentis. Au milieu même de la plus grande prospérité, l'incapacité à trouver des
repères crée une sourde insatisfaction.
L'économiste doit donc aujourd'hui élargir ses ambitions. Il
ne s'agit plus seulement de rechercher l'efficacité à partir de fonctions d'utilité et
de production données, mais de considérer la dynamique des fonctions d'utilité, qu'il
s'agisse de la consommation ou du loisir, lorsque les fonctions de production évoluent
plus vite que les modes de vie.
Nos sociétés pourront-elles assurer durablement leur
cohésion, comme elles tentent de le faire aujourd'hui, si elles tentent d'acheter par des
allocations la tranquillité des exclus tout en continuant à faire du travail salarié le
critère de l'intégration sociale ? Les nations riches peuvent-elles, dans un monde où
beaucoup de pays souffrent de la pénurie, se refermer sur elles-mêmes en cultivant la
morosité ? Peuvent-elles laisser la distribution des revenus avant impôts dériver vers
une répartition de plus en plus dispersée, quitte à la compenser en partie par une
redistribution fiscale de plus en plus difficile à administrer ? La foi des libéraux
dans le " laissez faire " et la " mort de l'État " est-elle la
meilleure réponse au bouleversement que comporte le STC, système à la fois hautement
productif et hautement risqué ?
Le STC, si on " laisse faire ", peut conduire à
une société où seule une minorité de personnes perçoivent le revenu de leur travail,
les autres vivant d'assistance sans travailler. La vie dans cette société peut prendre
encore des colorations diverses selon le statut social accordé à ceux qui travaillent et
à ceux qui ne travaillent pas : dans la démocratie grecque, les citoyens gouvernaient et
seuls les esclaves travaillaient. Mais la tendance, dans notre société, c'est de
considérer ceux qui travaillent comme des citoyens et ceux qui n'ont pas de travail comme
des exclus, même s'ils ont le droit de vote.
Ici s'ouvre un espace de choix qui n'est pas seulement celui de
l'économie, mais des valeurs humaines que la société entend respecter. Il y a bien des
façons pour une personne de répartir son temps entre travail, formation, culture,
environnement, vie affective et " farniente " ; il y a aussi bien des façons
pour une société de définir la sphère du travail productif (au sens exact du terme,
qui désigne la production d'utilité pour le consommateur). Ces choix supposent une prise
de conscience des enjeux du STC, puis une réflexion, que le " laisser faire "
ne peut remplacer.
Cet ouvrage ne prétend pas apporter à ces questions une
réponse définitive ; nous y reviendrons au chapitre XV. Voyons toutefois un exemple
des démarches qui peuvent aider à rendre le STC vivable : les services de
proximité.
Exemple: les services de proximité
Un des problèmes les plus difficiles aujourd'hui est de mettre
en œuvre une politique de création d'emplois permettant de sortir du dilemme entre
chômage de longue durée " à l'européenne " et emploi précaire des
travailleurs peu qualifiés " à l'américaine ", qui tous deux conduisent à
des formes d'exclusion et de rupture de la cohésion sociale.
Deux politiques de création d'emplois sont aujourd'hui menées
de front : l'une privilégie les services de proximité en abaissant leur prix soit par
des réductions des charges sur les salaires ou des baisses d'impôts, soit en
solvabilisant la demande ; l'autre privilégie les travailleurs les moins qualifiés en
abaissant les charges sociales sur les bas salaires.
Ces deux politiques visent à transformer l'assurance chômage,
devenue une redistribution passive vers les chômeurs de longue durée, en une
redistribution active dirigée vers les bas salaires ou vers un secteur pourvoyeur
d'emplois. Cependant il s'agit dans les deux cas de politiques redistributives. Or de
telles politiques ont l’inconvénient de distordre les coûts des facteurs de
production, donc les prix des produits, ce qui suscite à terme une inefficacité. Par
ailleurs, s'il s'agit de " faire payer les riches " (ou les revenus moyens), il
existe une limite que l'on ne peut dépasser sans susciter des comportements de fuite
(fraude fiscale, émigration).
Une autre solution serait d'infléchir la répartition primaire
par des politiques industrielles favorisant des gains de productivité. Les théories de
la croissance endogène indiquent en effet que la productivité n'est pas nécessairement
une donnée exogène, et qu'elle peut devenir une variable de pilotage.
Une telle solution suscite des réticences. Il peut d’abord
sembler paradoxal de proposer une politique de productivité pour traiter le problème de
l'emploi. Par ailleurs, la pertinence du raisonnement sectoriel est mise en doute par les
macroéconomistes, qui ont tendance à privilégier les raisonnements globaux. Enfin, se
référer à la théorie de la croissance endogène conduit à relier la productivité aux
décisions concernant l'offre, alors qu’il est habituel de la considérer
comme une tendance.
Si l'on mène une telle politique dans des secteurs où
production et productivité sont également faibles alors qu’existe une demande
latente, la hausse de la production crée des emplois, et la hausse de la productivité
suscite la qualification et permet d'augmenter les salaires. Cette politique évite donc
les écueils des " petits boulots " et du chômage subventionné conduisant à
l'exclusion.
Le secteur des services de proximité peut être le terrain
d'application de cette politique. L'intervention publique dans ce secteur a déjà une
importance telle qu'il serait possible d'obtenir, par réorientation des aides, de
meilleurs résultats sans coût supplémentaire.
Repères statistiques :
Les services de proximité représentent en 1997 400 000 emplois à
temps plein et 1 % de la consommation des ménages. Ils concernent surtout (75 %) la garde
d'enfants et l'aide aux personnes âgées.
La baisse des charges sur les bas salaires coûte à l'État 40
milliards de francs par an. Elle permet de créer 250 000 emplois. Elle coûte donc 200
000 francs par emploi et par an.
Les services de proximité actuels sont limités sous trois
points de vue:
- champ couvert : ils sont concentrés à 75 % sur la
garde d'enfants et l'aide aux personnes âgées. Un grand nombre de services de proximité
possibles et utiles sont non fournis : repassage du linge, nettoyage des voitures,
entretien de l'environnement, propreté et petit entretien des immeubles, etc.
- personnes servies
: les services sont orientés plutôt vers les personnes
aisées, ce qui est une anomalie s'agissant d'un secteur fortement aidé ;
- acteurs impliqués
: la structure des aides est dissuasive pour les
entreprises, qui ne sont pratiquement pas présentes dans l'offre.
L’offre est inexistante pour la plupart des services de
proximité, alors que des besoins nouveaux naissent du changement de mode de vie des
ménages à revenu intermédiaire. On peut transformer ces besoins en demande à condition
de respecter des conditions de qualité et de prix ; et l'offre peut être améliorée,
les bas niveaux actuels de productivité faisant de ce secteur un gisement de gains de
productivité et d'emplois.
Le premier volet de la politique d'organisation de l'offre
consisterait à supprimer les limitations actuelles du champ des services de proximité en
"neutralisant " l'intervention publique : il s'agit de supprimer les
distorsions entre types de prestataires en matière de TVA et de réductions des charges,
car elles ont pour effet, en favorisant les associations, d'interdire aux entreprises les
activités correspondant au champ aidé des " emplois familiaux ".
Par ailleurs la baisse des charges conforte les entreprises dans
la tendance à conserver l’organisation antérieure, compatible avec une faible
productivité, alors qu'elles devraient s’organiser pour être productives et ne se
tourner vers la puissance publique que si des externalités le justifient.
Le deuxième volet consiste à étendre aux services de
proximité les politiques actuellement centrées sur l'industrie et les services aux
entreprises. Il s'agit de mettre au point des incitations, d'organiser la concertation et
la coopération locales, de mettre à la disposition des offreurs de petite taille des
infrastructures de communication, d'information et de portage à domicile. Ces
infrastructures permettraient de diversifier les services tout en diminuant leur coût de
production, et de faire bénéficier les classes moyennes de services à temps partiel
réservés actuellement aux ménages aisés.
La politique d'incitation et de redistribution ci-dessus vise à
faciliter le passage à un équilibre économique conforme à la réalité des besoins et
aux capacités de l'appareil productif. Les besoins des ménages en service de proximité,
actuellement latents, seront satisfaits pour un prix raisonnable car ces services seront
produits par des entreprises efficaces dans des conditions conformes aux standards de
productivité actuels. Les emplois correspondants seront des emplois qualifiés ayant la
compétence nécessaire aux méthodes de travail d'une entreprise productive. Ces nouveaux
emplois faciliteront une sortie du chômage " par le haut " (c'est-à-dire par
la formation et la qualification), solution qui se distingue autant des " petits
boulots " peu qualifiés et peu payés à l'américaine, que de l'assistance au
chômage à l'européenne.
Annexe du chapitre III : Fonction de production
sectorielle
Supposons que la fonction de production des entreprises du
secteur est à facteurs complémentaires :
(1) Y = min (aKa ; bLb),
avec a, b, a, b > 0. Supposons b < 1 < a
Posons (1-2a)/a = g, (1-2b)/b = d, d - g = (1/b) - (1/a) = e.
Notons w et r les coûts unitaires des facteurs. Il est
facile de montrer que le coût moyen est minimal pour Y* tel que :
(2) Y* = {- [r( g+1) b1/b ]/[w(d+1)a1/a ]}1/e
Les quantités optimales des facteurs sont donc K* = (Y*/a)1/ a
et L* = (Y*/b)1/b
En équilibre concurrentiel, la production est assurée par un
grand nombre d’entreprises produisant chacune la quantité Y*. Le coût de production
unitaire est alors indépendant de la quantité produite car la fonction de coût
sectorielle est linéaire, l'augmentation du volume produit se faisant par
création de nouvelles entreprises. Le coût par unité produite est :
(5) c(Y*)/Y* = wY*(1- b)/b/b1/b + rY*(1-a)/a/a1/a
Quand les coûts des facteurs de production varient, la
quantité Y* produite par une usine varie, ainsi que la combinaison des facteurs de
production. Il en résulte que la fonction de production sectorielle est une Cobb-Douglas
à rendement constant :
(6) Y = BKAL(1 - A),
l’effet d ’échelle étant obtenu par la
multiplication du nombre d ’unités de production identiques.
Évaluons les coefficients de cette loi en fonction de ceux de la
fonction de production microéconomique :
(7) K*/L* = - (w/r)( d+1)/(g+1)
Lorsque le rapport w/r varie, le rapport K*/L* varie en raison
de la modification de Y* et de la relation fonctionnelle qui lie Y*, K* et L*.
Le coefficient A de la loi de Cobb-Douglas sectorielle est tel
que :
(8) K*/L* = (w/r)[A/(1 - A)], d ’où
(9) A/(1 - A) = - ( d+1)/(g+1), donc :
(10) A = a(1
- b)/(a - b) et 1 - A = b(a - 1) /(a - b)
Pour déterminer la valeur du coefficient B de la loi de
Cobb-Douglas sectorielle, supposons le secteur réduit à une seule
entreprise employant K* et L*. On a alors :
(11) Y* = B(Y*/a)A/ a(Y*/b)(1-A)/b
= BY*/a(1-b)/(a-b)b(a-1)/(a-b)
D ’où :
(12) B = a(1- b)/(a-b)b(a-1)/(a-b)
La fonction de production sectorielle est donc :
(13) Y = [a(1- b)b(a-1)KKa(1 - b)L(a - 1)b]1/(a - b)
Cette expression ne dépend pas de w et de r : la fonction
de production sectorielle est donc reliée à la fonction de production physique
d’une entreprise particulière, indépendamment des prix des facteurs.
|